Fado Vitória. 5. Povo que lavas no rio (Amália) [2e partie]
Fait suite à :
………
Amália Rodrigues (1920-1999) • Povo que lavas no rio. Pedro Homem de Mello, paroles ; Joaquim Campos, musique (Fado Vitória).
Amália Rodrigues, chant ; José Nunes, guitare portugaise ; Castro Mota, guitare.
Enregistrement : Lisbonne, Teatro Taborda, entre 1960 et 1962.
Première publication dans l’album Asas fechadas ; Cais de outrora ; Estranha forma de vida ; etc. (« Busto »). Royaume-Uni, Columbia, ℗ 1962.
………
« Peuple ! Peuple ! Je t’appartiens »
« Povo que lavas no rio » est tiré d’un livre. Comme le poème est très long, j’en ai extrait les parties les plus dramatiques que j’ai arrangées entre elles, mais il contient d’autres très beaux passages. J’ai ajusté [le fado Vitória] à ces vers et je trouve que ça marche bien.
Amália Rodrigues (1920-1999), dans : Vítor Pavão dos Santos, Amália, uma biografia, 2a ed., Lisboa, Ed. Presença, 2005, ISBN 972-23-3468-9, p. 96. Non traduit (traduction L. & L.).
Ce « livre » est le recueil Miserere, publié en 1948, du Nordiste Pedro Homem de Mello (1904-1984), que l’anthologie La Poésie du Portugal (Chandeigne, 2021) présente ainsi :
Né à Porto, lié au mouvement de Presença*, ce poète prolifique, auteur d’une trentaine de recueils en un demi-siècle […] a hérité la musicalité intimiste et quelque chose de la respiration mélodieuse des prosodies chères aux adeptes de ce « second modernisme** ». Vasco Graça Moura évoque à son sujet « un monde intérieur traduisant une tension entre l’angoisse, le remords, la faute et le vertige érotique », soulignant comment ce folkloriste de renom, qui s’est attaché à distiller les plus authentiques traditions du Portugal, avait su les épurer poétiquement. Il est mort dans sa ville natale.
Ana Torres, Melo, Pedro Homem de [Pedro da Cunha Pimentel Homem de Melo] (1904-1984), dans : Max de Carvalho (dir.), La poésie du Portugal : des origines au XXe siècle, éd. bilingue, Chandeigne, 2021, ISBN 978-2-36732-207-0, p. 1821.
* La revue Presença (1927-1940) a été l’une des plus importantes revues littéraires portugaises du 20e siècle.
** Le « second modernisme » renvoie au groupe de Presença, le « premier modernisme » faisant référence au mouvement de la revue Orpheu, marqué à partir de 1915 par les personnalités de Mário de Sá-Carneiro, Fernando Pessoa et d’autres.
Le poème, trop long pour être chanté en entier (52 vers), s’appelle simplement Povo (« Peuple »). Par une habile opération de chirurgie textuelle, Amália est parvenue à le réduire à 24 vers répartis en quatre sizains, sans trop en altérer l’essence. Le voici, accompagné d’une traduction sommaire (en gris, les parties non retenues pour le fado ; en bistre, deux vers inversés).
Povo Peuple
Povo que lavas no rio,
Que vais às feiras e à tenda,
Que talhas com teu machado
As tábuas do meu caixão,
Pode haver quem te defenda,
Quem turve o teu ar sadio,
Quem compre o teu chão sagrado,
Mas a tua vida, não!
Peuple, qui laves dans le fleuve,
Qui vas à la foire et au marché,
Toi dont la hache abat
Le bois de mon cercueil,
Il y en a peut-être qui te défendent,
Qui troublent ton air pur,
Qui achètent ton sol sacré,
Mais ta vie — non !
Meu cravo branco na orelha!
Minha camélia vermelha!
Meu verde manjericão!
Ó natureza vadia!
Vejo uma fotografia…
Mas a tua vida, não!
Mon œillet blanc à l’oreille,
Mon camélia vermeil
Et mon vert basilic !
Ô nature fantasque !
Je vois une photographie…
Mais ta vie — non !
Fui ter à mesa redonda,
Bebendo** em malga que esconda
O beijo, de mão em mão…
Água pura, fruto agreste,*
Fora o vinho que me deste,*
Mas a tua vida, não!
Je suis allé à la table ronde,
J’y ai bu au bol qui dissimule
Le baiser, de main en main…
Eau pure, fruit sauvage,*
C’était le vin que tu m’avais donné,*
Mais ta vie — non !
Procissões de praia e monte,
Areais, píncaros, passos
Atrás dos quais os meus vão!
Que é dos cântaros da fonte?
Guardo o jeito desses braços…
Mas a tua vida, não!
Processions par grèves et par monts,
Rivages, sommets ; et ces pas
Dans lesquels je mets les miens !
Où sont les cruches de la fontaine ?
Je garde en moi l’agilité de ces bras…
Mais ta vie — non !
Aromas de urze e de lama
Dormi com eles na cama
Tive a mesma condição.
Bruxas e lobas, estrelas!
Tive o dom de conhecê-las…
Mas a tua vida, não!
Arômes de bruyère et de boue !
C’est avec eux que j’ai dormi…
J’ai partagé leur condition.
Sorcières, louves, étoiles !
Il m’a été donné de les connaître…
Mais ta vie — non !
Subi às frias montanhas,
Pelas veredas estranhas
Onde os meus olhos estão.
Rasguei certo corpo ao meio…
Vi certa curva em teu seio…
Mas a tua vida, não!
Je suis monté sur de froides montagnes,
Par d’étranges sentiers
Où mes yeux demeurent encore.
J’ai lacéré certain corps…
J’ai vu certain galbe de ton sein…
Mais ta vie — non !
Só tu! Só tu és verdade!
Quando o remorso me invade
E me leva à confissão…
Povo! Povo! eu te pertenço.
Deste-me alturas de incenso,
Mas a tua vida, não!
Toi seul ! Toi seul es vérité !
Quand le remords me submerge
Et m’entraîne à la confession…
Peuple ! Peuple ! Je t’appartiens.
Tu m’as donné des cieux d’encens,
Mais ta vie — non !
Povo que lavas no rio,
Que vais às feiras e à tenda,
Que talhas com teu machado
As tábuas do meu caixão,
Pode haver quem te defenda,
Quem turve o teu ar sadio,
Quem compre o teu chão sagrado,
Mas a tua vida, não!
Peuple, qui laves dans le fleuve,
Qui vas à la foire et au marché,
Toi dont la hache abat
Le bois de mon cercueil,
Il y en a peut-être qui te défendent,
Qui troublent ton air pur,
Qui achètent ton sol sacré,
Mais ta vie — non !
Pedro Homem de Melo (1904-1984). Povo, extrait du recueil Miserere (1948).
* Dans le fado, ces deux vers sont inversés.
* Dans le fado : « Beber » (infinitif) au lieu de « Bebendo » (gérondif).Pedro Homem de Melo (1904-1984). Peuple, trad. par L. & L. de Povo, extrait du recueil Miserere (1948).
* Dans le fado, ces deux vers sont inversés.
.
.
Une fois les coupures pratiquées, le propos ne s’en concentre que davantage sur la relation du poète au « peuple », faite d’une revendication d’inclusion (« Peuple ! Peuple ! je t’appartiens ») et tout à la fois de la conscience d’un abîme infranchissable (« Tu m’as donné des cieux d’encens, / Mais pas ta vie !), comme si le « peuple » opposait à son désir une fin de non recevoir.

Pedro Homem de Mello, bloc avec timbre-poste (Portugal, 2004), détail.
Pour Homem de Mello, ce fossé tient à la fois à son origine sociale (il était né au sein d’une famille bourgeoise, catholique et conservatrice de Porto) et probablement aussi au fait qu’il était bisexuel : sa poésie reste le plus souvent allusive à ce sujet, mais ne laisse guère de doute sur la nature de l’attirance qu’éveillent en lui les hommes du « peuple », non sans y susciter un vif et douloureux sentiment de faute. Certains des poèmes du recueil Miserere renoncent d’ailleurs à toute ambiguïté, comme Remorso (« Remords »), dont est issu le texte du fado O rapaz da camisola verde (« Le garçon au chandail vert »). Or dans Nostalgia (« Nostalgie ») — un texte clairement homo-érotique du même recueil —, les « lits de bruyère et de boue » abritent des étreintes viriles, « au cœur de la nuit, loin des regards » :
Existe a paixão? Existe.
E há leitos de urze e de lama…
Olhos vítreos de cansaço?
Mão pesada? Negras unhas?
Mas que paz naquele abraço,
Noite alta, sem testemunhas!
Est-ce que l’amour existe ? Oui.
Et il y a des lits de bruyère et de boue…
Des yeux vitreux de fatigue ?
Une main épaisse, aux ongles noirs ?
Mais quelle paix dans cette étreinte,
Au cœur de la nuit, loin des regards !
Pedro Homem de Melo (1904-1984). Nostalgia (fragment), extrait du recueil Miserere (1948).
.Pedro Homem de Melo (1904-1984). Nostalgie (fragment), trad. par L. & L. de Nostalgia, extrait du recueil Miserere (1948).
Ces « lits de bruyère et de boue » font écho, de manière flagrante, aux « arômes de bruyère et de boue » des lits de Povo (« Arômes de bruyère et de boue ! / C’est avec eux que j’ai dormi… / J’ai partagé leur condition ») et les éclairent d’un jour particulier.
Restent, dans Povo, ces trois vers mystérieux : « Fui ter à mesa redonda, / Bebendo em malga que esconda / O beijo, de mão em mão… » (traduits littéralement : « Je suis allé à la table ronde, / Buvant au bol qui dissimule / Le baiser, de main en main… »). Dans un enregistrement d’amateur réalisé en 1960 par César Seabra, qui n’était pas encore à l’époque le mari d’Amália, on l’entend lui-même s’interroger — et interroger sa compagne : « Ça veut dire quoi, ‘le bol qui dissimule’ ? » Ce à quoi ladite compagne n’a pas vraiment de réponse. À la lumière de ce qui précède on peut cependant s’en faire une idée.
Moi je suis du peuple !
Pedro Homem de Mello a fourni à Amália les textes de quelques-uns de ses plus beaux fados. Elle en a adapté certains à des musiques de fados traditionnels, comme pour Povo (Fria claridade ; Olhos fechados…), d’autres ont été mis en musique par Alain Oulman (Cuidei que tinha morrido et d’autres).
Pedro Homem de Mello était un homme extraordinaire. Il avait une manière d’être portugais qui me plaisait. Il avait un amour profond pour le Portugal. Il aimait la musique de sa région, c’était un homme à ma façon. Et un grand poète. Quand il donnait le meilleur de lui-même il égalait García Lorca. […] Tous les textes de lui que je chante sont beaux, je ne saurais même pas dire lequel je préfère.
Amália Rodrigues (1920-1999), dans : Vítor Pavão dos Santos, Amália, uma biografia, 2a ed., Lisboa, Ed. Presença, 2005, ISBN 972-23-3468-9, p. 97. Non traduit (traduction L. & L.).
Amália éprouvait elle aussi cet « amour profond pour le Portugal » qu’elle reconnaît au poète et dont elle voyait en Povo que lavas no rio une expression idéale. Née dans un milieu des plus modestes, obligée de travailler très jeune et n’ayant donc reçu qu’une éducation sommaire, elle s’était acquis dès ses premiers succès une aisance matérielle confortable. Peu à peu, s’affirmant comme une personnalité importante de son pays, elle a pu évoluer dans des cercles artistiques et même intellectuels bien éloignés de l’environnement de son enfance. Elle avait le goût de la poésie ; elle en était une lectrice avisée.
C’est à dire que son parcours était en quelque sorte l’inverse de celui de Pedro Homem de Mello : aujourd’hui on la qualifierait de « transclasse ». Elle-même se déclarait inculte et n’a jamais renié ses origines, bien au contraire : elle ne manquait pas une occasion de rappeler qu’elle était issue du peuple. Il lui est arrivé de s’en faire une arme, par exemple lors de l’incroyable polémique suscitée en 1965, notamment au sein d’une certaine élite intellectuelle conservatrice, par le fait qu’elle se soit autorisée à chanter Camões, le « poète national » :
J’ai chanté ces poèmes parce qu’ils me plaisaient. Les vers que les poètes écrivent sont là pour être chantés et pour qu’on les fasse connaître. Les poètes appartiennent au peuple : moi je suis du peuple !
Amália Rodrigues (1920-1999). Extrait de l’article Amália canta Camões: acha bem? Acha mal? [« Amália chante Camões : d’accord ? Pas d’accord ? »], dans : Diário Popular, Lisboa, 23 octobre 1965. Traduction L. & L.
Elle a cru que l’amour passionné qu’elle portait au Portugal et à son « peuple » lui était rendu dans une aussi grande mesure. L’avènement, le 25 avril 1974, de la Révolution des œillets et l’effervescence qui s’est ensuivie avec ses désirs de vindicte l’ont dessillée en quelques jours. Rumeurs malveillantes sur son prétendu lien avec l’ancien régime et sa police politique (qui la tenait quant à elle pour une sympathisante communiste), attaques, perfidies, abandon de la part d’anciens amis, ostracisme, insultes, l’ont laissée stupéfaite et durablement meurtrie. « Mais pourquoi tout ça ? Pourquoi tant de haine ? » s’interroge-t-elle dans son autobiographie. « J’y ai perdu toute ma naïveté. » Cette colère, qui lui est restée jusqu’à sa mort, intacte, s’exerçait exclusivement à l’endroit de ceux qui ont tenu le haut du pavé après le 25 avril, grosso modo pendant la période du « PREC » (Processo Revolucionário Em Curso, le « Processus révolutionnaire em cours », qui a pris fin avec l’adoption de la nouvelle constitution en avril 1976). Car, se récriait-elle, « le public ne m’a jamais abandonnée. »
Il n’y a que le public qu’ils n’ont pas réussi à monter contre moi. Dès le mois de juin [1974] je suis allée chanter au Coliseu* et, dès que je suis entrée en scène, le public s’est levé pour m’applaudir. Le public ne m’a jamais abandonnée.
Amália Rodrigues (1920-1999), dans : Vítor Pavão dos Santos, Amália, uma biografia, 2a ed., Lisboa, Ed. Presença, 2005, ISBN 972-23-3468-9, p. 163. Non traduit (traduction L. & L.).*Le Coliseu dos Recreios, l’une des plus grandes salles de spectacle de Lisbonne. Amália fait référence à « Somos a canção que somos » (« Nous sommes la chanson que nous sommes »), un spectacle collectif organisé dans cette salle le 4 juillet 1974 par le Syndicat des artistes de théâtre, auquel elle a participé et où elle a, en effet, été particulièrement applaudie.
L’amie du peuple
La tempête a fini par s’apaiser. En 1986, au cours des entretiens dont allait résulter son autobiographie (publiée l’année suivante), elle avait ce propos assez singulier :
Il y a beaucoup d’amitié entre le peuple portugais et moi. Je fais partie des amis des Portugais, ils ne me voient pas comme artiste. C’est à cela que j’attache le plus de prix. Quand ils me voient, ils comprennent que celle qui est là, qui chante de cette façon-là, avec ce visage-là, ne peut pas être éloignée d’eux, que c’est forcément quelqu’un de très proche.
Amália Rodrigues (1920-1999), dans : Vítor Pavão dos Santos, Amália, uma biografia, 2a ed., Lisboa, Ed. Presença, 2005, ISBN 972-23-3468-9, p. 181. Non traduit (traduction L. & L.).
À l’époque, le vent a déjà tourné et souffle en sa faveur. Les reconnaissances officielles dont l’État portugais commence à l’honorer, à partir de 1980, le confirment. De tous côtés les hommages se multiplient et, lorsqu’elle investit en 1985 le Coliseu dos Recreios de Lisbonne pour son premier véritable récital dans la capitale, elle y est accueillie en triomphe.
En 1987, dans le même théâtre, elle vit une apothéose. La télévision a enregistré ce récital, publié en outre par sa maison de disques, quelques mois plus tard, sous la forme d’un triple album. Le public en adoration, indifférent à l’altération flagrante de sa voix, l’accompagne de son exaltation tout au long du spectacle, dont le clou est un Povo que lavas no rio poignant, porté à maintes reprises, pendant son exécution, par les applaudissements et les clameurs. Le fado achevé, le public est dans un état de folie. Elle reste immobile, interdite, telle une madone en son sanctuaire. Des fleurs blanches aux tiges aussi grosses que des poireaux sont projetées depuis les premiers rangs vers le proscenium où elles retombent comme une écume, à ses pieds, sur sa robe. Le tumulte est celui d’un ébranlement. Parfois elle se retourne vers ses guitaristes, on la voit chasser une larme à une ou deux reprises. Elle ne parvient à prononcer son habituel Muito obrigada!, « Merci beaucoup ! » qu’au bout d’une minute vingt d’acclamations de la foule, qui se met alors à scander « Amália ! Amália ! Amália ! » (voir la vidéo ici).
………
Amália Rodrigues (1920-1999) • Povo que lavas no rio. Pedro Homem de Mello, paroles ; Joaquim Campos, musique (Fado Vitória).
Amália Rodrigues, chant ; Carlos Gonçalves & Pinto Varela, guitare portugaise ; António Moliças, guitare ; Joel Pina, basse acoustique.
Enregistrement public : Lisbonne, Coliseu dos recreios, 3 avril 1987.
Extrait de l’album : Coliseu, Lisboa, 3 de Abril 1987 / Amália. Portugal, Valentim de Carvalho, ℗ 1987.
………
Il faut qu’elle dise quelque chose. Alors, elle évoque une réponse qu’elle donne toujours, qu’elle a toujours donnée, depuis le début, et qu’elle donne encore ce soir-là ; elle ne dit pas à quelle question.
Há muito tempo, há quarenta e sete anos que ando a dizer a mesma coisa e dizem que eu sempre respondo a mesma coisa. Hoje tenho que responder sempre a mesma coisa. Acho que vocês, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, gostam de mim. E eu gosto de vocês. Muito obrigada.
Amália Rodrigues (1920-1999). [Adresse au public, après le fado « Povo que lavas no rio »], extrait du récital donné par la chanteuse le 3 avril 1987 au Coliseu dos Recreios, Lisbonne, publié dans l’album : Coliseu, Lisboa, 3 de Abril 1987, Portugal, V. de Carvalho, ℗ 1987.Il y a longtemps, il y a 47 ans que je dis la même chose, qu’on dit que je réponds toujours la même chose. Aujourd’hui je ne peux que répondre encore la même chose : Je pense que vous, Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci, vous m’aimez. Et moi je vous aime. Merci beaucoup.
Amália Rodrigues (1920-1999). [Adresse au public, après le fado « Povo que lavas no rio »], extrait du récital donné par la chanteuse le 3 avril 1987 au Coliseu dos Recreios, Lisbonne, publié dans l’album : Coliseu, Lisboa, 3 de Abril 1987, Portugal, V. de Carvalho, ℗ 1987. Traduction L. & L.
………
Discographie
Liste des enregistrements publiés (au 4 mars 2023) de Povo que lavas no rio par Amália Rodrigues, ordonnés par date d’enregistrement.
………
À suivre.
Trackbacks
- Fado Vitória. 4. Povo que lavas no rio (Amália) [1ère partie] | Je pleure sans raison que je pourrais vous dire
- Fado Vitória. 2. Maria Teresa de Noronha, José Porfírio | Je pleure sans raison que je pourrais vous dire
- Fado Vitória. 1. Joaquim Campos, Camané, Maria Alice | Je pleure sans raison que je pourrais vous dire
- Fado Vitória. 3. Igreja de Santo Estêvão | Je pleure sans raison que je pourrais vous dire
![Amália Rodrigues (1920-1999). [Busto], nouvelle édition augmentée (2021)](https://jepleuresansraison.files.wordpress.com/2021/12/amaliabusto2021.jpg?w=150&h=150)
![Amália Rodrigues (1920-1999). [Busto] (1962).](https://jepleuresansraison.files.wordpress.com/2023/03/bustouk-1.jpg?w=148&h=150)



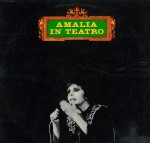
![Amália Rodrigues (1920-1999). Estranha forma de vida [Live in Japan 86] (1986)](https://jepleuresansraison.files.wordpress.com/2023/03/estranhaformadevidalivejapan86.jpg?w=150&h=147)





Eh bien, cela valait la peine d’attendre. Quelle richesse que ces deux billets ! Le contenu est digne d’un véritable article et cela a dû vous demander beaucoup de travail de recherche. Bravo et merci.
Je n’ai que très rarement entendu ce fado chanté sur les vers de « Povo… » dans les maisons de fado à Lisbonne, alors qu’il n’est pas rare d’y entendre « Cansaço », « Maldição », ou même « Estranha forma de vida », qui sont devenus le bien commun des fadistes. Amália en a tellement marqué l’interprétation que plus personne n’ose s’y risquer. A moins que ce soit l’aspect par moments un peu énigmatique du texte qui rende difficile son appropriation.
Sur un plan plus personnel, j’aimerais savoir ce qu’il signifie pour vous, ce fado Vitória, et « Povo… » en particulier. Je suppose que vous avez eu la chance d’entendre Amália le chanter en public ? Quelle impression en avez vous gardé ?
Merci beaucoup. Le fait est qu’il y avait de la matière. Il a même fallu élaguer.
Il me semble assez naturel que les fadistes (je ne parle pas de vedettes du showbiz comme Mariza, Dulce Pontes ou autres) n’osent pas s’aventurer dans Povo que lavas no rio. À la certitude d’être comparés au modèle (en leur défaveur, fatalement), s’ajoute probablement une forme de pudeur, de réserve, de respect.
Quant à votre question sur ma propre expérience : chaque fois que j’ai assisté à un récital d’Amália (ce que je n’ai pu faire qu’à partir de 1985), elle a chanté Povo que lavas no rio. Malgré sa voix changée, parfois dégradée, Povo était toujours un moment de grâce. C’est un des titres de son répertoire qui a plutôt bénéficié de l’emprise de l’âge sur elle — au contraire des œuvres d’Alain Oulman par exemple, du moins en règle générale. Il est vrai qu’elle y mettait tout le poids de sa « vie vécue », pour paraphraser Argentina Santos. C’était vraiment son fado à elle, plus que tout autre ; le poème n’était plus vraiment celui de Homem de Mello, elle l’avait détourné à son profit, en quelque sorte. « Boire au bol qui dissimule le baiser » a un sens dans le poème original, mais je ne sais vraiment pas comment Amália comprenait ce passage, ni si elle y accordait de l’importance. J’ai l’impression que non. Il me semble que pour elle, le poids du fado reposait surtout sur la 1ère et la 3e strophe (et la 4e, qui reprend la première).